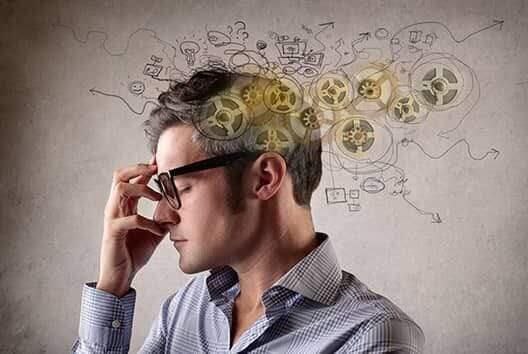Association des équipements médicaux et pharmaceutiques / La « divagation mentale » (Mind Wandering) est définie comme un état instable de concentration dans lequel l’individu ne parvient pas à maintenir son attention sur le sujet actuel et ses pensées dérivent inconsciemment vers le passé, le futur ou des sujets non liés. Lorsque cet état devient chronique et que le contenu mental est principalement négatif, répétitif et inefficace, les psychologues parlent de « rumination ». Chizari considère la rumination non seulement comme un défi individuel, mais comme une menace globale pour la productivité sociale, la cohésion familiale et même l’économie de la santé.
Contrairement aux pensées passagères ou aux rêveries neutres, la rumination tourne souvent autour du sentiment de culpabilité, de la dévalorisation, de l’inquiétude pour l’avenir ou d’une révision amère du passé. Des études en neurosciences montrent que, pendant la rumination, certaines zones du cerveau comme le cortex préfrontal et le réseau en mode par défaut (Default Mode Network) sont hyperactives ; le cerveau est donc engagé dans des activités mentales répétitives, sans résultats, et accompagnées d’anxiété. Cette situation épuise non seulement l’énergie psychique de la personne, mais est directement liée à des troubles de l’humeur tels que la dépression majeure, l’anxiété généralisée, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et le trouble obsessionnel-compulsif (TOC).
Chizari avertit que si la rumination n’est pas identifiée et prise en charge à temps, elle peut créer un cercle vicieux : la personne perd sa concentration et son efficacité à cause des pensées envahissantes ; les échecs qui en résultent renforcent le sentiment d’incapacité ; et ce sentiment nourrit à nouveau la rumination. Ce cycle, en l’absence d’une intervention professionnelle, peut durer des années et entraîner des conséquences telles que l’isolement social, les troubles du sommeil, l’incapacité à prendre des décisions, le manque de motivation et même des pensées auto-destructrices.
De plus, Chizari souligne que bien que la rumination soit un processus mental interne, elle a des effets externes importants. Par exemple, dans le domaine de la santé au travail, les employés souffrant de rumination chronique présentent plus fréquemment un épuisement professionnel, des erreurs répétées, des absences prolongées et une insatisfaction au travail. Dans le système éducatif, un élève ou étudiant dont l’esprit est constamment occupé par des échecs passés ou des peurs de l’avenir ne peut pas apprendre efficacement. À l’échelle macro, ce phénomène peut réduire la productivité de la main-d’œuvre et augmenter considérablement les coûts psychiatriques du système de santé.
Sur le plan social, Chizari relie la rumination à l’augmentation des taux de divorce, à la baisse de la tolérance sociale et aux dysfonctionnements institutionnels. Selon lui, la rumination est un facteur caché dans la baisse du seuil de tolérance publique et l’augmentation des tensions dans les organisations et les familles. Aussi, en politique, les décideurs enfermés dans un cycle mental négatif peuvent ne pas parvenir à une compréhension globale des intérêts nationaux et collectifs. Ainsi, s’occuper de cette problématique est important non seulement pour la santé individuelle, mais aussi pour une meilleure gouvernance.
Chizari classe les stratégies de gestion de la rumination en trois niveaux : prévention, intervention psychothérapeutique et réhabilitation sociale. Au niveau préventif, l’enseignement des compétences de pleine conscience, de résilience, de gestion du stress et de régulation émotionnelle via les écoles, les médias et les environnements professionnels joue un rôle clé. Il insiste sur la nécessité d’intégrer l’éducation à la santé mentale dans les programmes scolaires et universitaires, et demande une coopération entre les associations professionnelles et les médias pour la sensibilisation publique. Il cite en exemple les programmes scandinaves qui, grâce à une éducation massive des jeunes, ont significativement réduit les troubles de l’humeur et l’auto-mutilation.
En intervention, il mentionne spécifiquement la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui, en modifiant les schémas de pensée destructeurs, aide à briser le cycle de la rumination. La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) et la thérapie comportementale dialectique (TCD) sont également efficaces dans certains cas. Dans les cas graves, il recommande l’usage d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques, toujours sous surveillance psychiatrique et suivi régulier. Il souligne que le traitement ne se limite pas à la médication ; la participation active du patient, la reconstruction du mode de vie, une communication efficace avec le thérapeute et le retour progressif aux activités quotidiennes sont des éléments complémentaires indispensables.
Chizari souligne aussi le rôle incontournable des familles, amis et aidants dans le processus thérapeutique. Selon lui, la personne en proie à la rumination a avant tout besoin d’être écoutée, de recevoir de l’empathie et de sentir une sécurité psychologique. Il recommande aux proches de pratiquer l’écoute active plutôt que de donner des solutions stéréotypées ou des jugements. Des rappels doux pour la prise des médicaments, l’accompagnement aux séances de thérapie, l’aide à instaurer des habitudes saines (comme un sommeil régulier et de l’exercice) ainsi qu’un environnement sécurisé peuvent accélérer la guérison.
Enfin, Chizari critique le manque d’attention institutionnelle à la santé mentale. Il affirme que tout comme on accorde de l’attention aux équipements médicaux physiques, « l’équipement mental » de la société doit être soutenu. Autrement dit, l’allocation budgétaire pour les services psychothérapeutiques, la prise en charge par les assurances des consultations, la formation de psychologues dans les centres locaux et le soutien médiatique aux discussions publiques sur la santé mentale doivent devenir des priorités du système de santé iranien.
Il met en garde que dans un monde où la solitude numérique, l’insécurité économique et l’épuisement mental augmentent chaque jour, l’indifférence des institutions spécialisées, des médias, des associations professionnelles et des décideurs politiques face à la rumination conduira à une génération extérieurement saine mais intérieurement épuisée et démotivée.
Pour conclure, en insistant sur le rôle clé des associations professionnelles en matière de santé mentale, il propose que l’Association des équipements médicaux et pharmaceutiques de la province de Téhéran, en collaboration avec des psychologues, lance des campagnes de sensibilisation, élabore des brochures éducatives pour les patients et leurs familles, et crée des cliniques de conseil dans les zones défavorisées ; une étape qui pourrait offrir un nouveau modèle d’intégration entre santé physique et mentale dans le pays. Selon lui, cela constitue une responsabilité éthique de chaque corps de métier lié à la santé.
Dans ce texte, Alireza Chizari agit non seulement en tant que représentant professionnel, mais aussi comme une voix de responsabilité sociale, cherchant à attirer l’attention de la société, des médias et des autorités sur un phénomène silencieux, mais dont les effets sont profonds et durables. Un esprit épuisé engendre un corps malade ; et une société dont les esprits sont prisonniers de la rumination ne pourra jamais avancer avec force sur la voie du développement, du bien-être et de la justice.